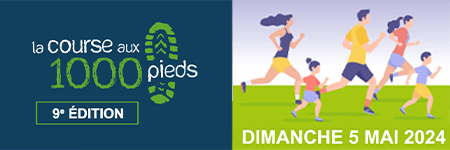Un brave
Je suis parti courir. À Roberval, au Lac-St-Jean, à rattraper le temps perdu pour cause de Covid. En courant le long du lac, je suis passé devant l’hôpital, là où j’ai travaillé mes étés d’étudiant, en 1972, 1973 et 1974. Là où j’ai été un brave.
Vous me direz que pour travailler dans un hôpital, il faut nécessairement être brave. C’est vrai. Mon cas était quand même un peu particulier. La job impliquait de se lancer dans le vide. Littéralement, se lancer dans le vide. Le dos tourné. À 30 mètres de haut.
Mon oncle était Alfred était le patron de l’entretien à l’hôpital. Grâce à lui, j’avais une place dans l’équipe qui nettoyait, l’été, les fenêtres de l’établissement. Toutes les fenêtres. Y’en a 1000? 1500? À l’intérieur, mais surtout à l’extérieur. On est en 1972, avant la CSST, avant les MAT (méthodes appropriées de travail) et les équipements de sécurité. Avant la possibilité de lever la main pour dire « Non, je ne suis pas assez fou pour faire ça ».
Un lundi matin de juin, on se présente à l’atelier, les trois autres gars de l’équipe et moi. Rencontre monsieur Bélanger (qui deviendra vite pour nous Monsieur B), employé « de la maintenance ». Il va nous initier au travail de laveur de vitre. On prépare d’abord le matériel qui tient sur deux chariots : poches de guenilles, éponges, « gratteux » à lames de rasoir, chaudières et des contenants d’ammoniaque qu’on diluera dans de l’eau chaude en guise de nettoyant.
Parlant d’ammoniaque Monsieur B. prend le temps de nous expliquer que l’ammoniaque concentré ça « sent fort ». Alors, pour ne pas déranger l’entourage lorsqu’on le transvide d’une grande urne de verre à des contenants de plastiques plus commodes pour le transport, on s’enferme dans un placard. Faut faire vite en respirant le moins possible.
Des vapeurs d’ammoniaque, concentré calibre industriel, dans un espace clos, pendant plusieurs minutes. Tous les jours pour partir la journée. Est-ce que je vous ai dit que c’était avant la CSST?
J’en étais où? Ah oui, le matériel. Une fois les chariots chargés, il ne manquait que le principal, le harnais. Une ceinture de cuir avec des bretelles, des emplacements pour les outils et deux crochets de métal. L’enfant bâtard d’une ceinture d’ouvrier et d’un accessoire de costume médiéval. Monsieur B. voit bien qu’on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il va nous l’apprendre.
Ascenseur de service jusqu’au 6e étage. On trouve une chambre vide. Monsieur B. ouvre une fenêtre en remontant le bas. Il nous montre deux minuscules crochets sur les côtés extérieurs: « On met le harnais et on sort. On se tient en équilibre, les pieds sur le montant en briques pis on se relève en se tenant après la petite poignée ici. Ensuite, on pose les encrages sur les crochets. Quand c’est fait, il reste juste à se laisser tomber vers l’arrière, la courroie s’étire et vous allez pouvoir laver l’extérieur comme ça ».
Pardon!?!
– Le harnais date d’au moins vingt ans
– Les crochets sont gros comme des dix cents.
– Le montant de la fenêtre mesure deux pouces (je chausse des 11).
– La poignée pour se lever permet de rentrer au plus trois doigts.
o Elle tient par deux vis d’un demi-pouce.
– On est au 6e étage.
– Au-dessus d’un stationnement.
Monsieur B. retient un petit sourire en coin. On est un juin mais je pense que pour lui, c’est un peu Noël.
J’ai regardé le harnais, la fenêtre ouverte, pas trop le stationnement. J’ai réalisé que si je n’y allais pas le premier, je n’oserais jamais le faire. Alors j’ai dit : « J’y vas! ». J’ai enfilé le harnais et je suis sorti. Je me suis relevé en collant la fenêtre comme une sangsue. J’ai accroché les encrages en tremblant et je me suis peureusement laissé aller vers l’arrière en priant pour que ça tienne. Ça a tenu.
Le temps de laisser mes genoux cesser de claquer ensemble j’ai apprivoisé la place. Pas mal comme vue! J’ai fini par rentrer, sous le regard admiratif de mes collègues. Même Monsieur B. a eu l’air de se dire : « il est brave, le flot ».
Je n’ai jamais osé leur dire que ce n’était pas de la bravoure. Juste une bonne gestion de « avoir la chienne ». Faire une bonne première impression, ça vaut cher.
N.B. Toutes les chroniques Parti courir sont disponibles sur le site www.particourir.com