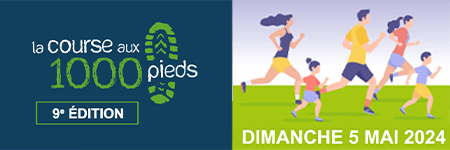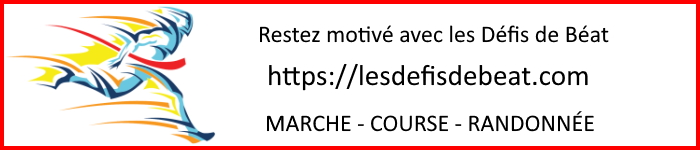par François Léger Dionne | 22 Mar 2021 | En liberté, Voyage
Mars annonce le printemps, et le printemps annonce Boston. Plutôt, le printemps est l’apanage de Boston, ville sur laquelle s’échoue le plus vieux marathon au monde, qui ouvre dans la plupart des esprits la saison des grandes courses. Il y a certes Tokyo en février et Londres en avril, mais le rêve est perpétuellement américain. C’est sur les terres du Massachusetts, là où s’est construite l’Amérique, que les coureurs rêvent au moins une fois d’user leurs petites semelles sur la grande ornière de l’Histoire.
J’y étais, il y a deux ans.
Je me souviens, gamin ou ado, être tombé à quelques reprises sur le marathon de Boston à la télé, toujours un lundi de grisaille, chose inouïe puisque dimanche clôturait habituellement le noble sport (d’endurance, j’entends) au petit écran. Mon père m’avait alors raconté l’histoire de Jacqueline Gareau et de Rosie Ruiz. Mais j’en savais peu, et m’intéressais de loin à ces choses au si long cours, en la monotonie desquelles je m’inclinais avec égards mais sans ambages, laissant les autres battre le plat bitume, batailler interminablement hors des forêts, hors des montagnes, en dehors de tout véritable paysage, dans quelque bled prosaïque, sur des rues dont les noms rappelaient trop bien ma morne existence citadine.
Puis, le lundi 15 avril 2019, j’étais de ces autres, dans un bled nommé Hopkinton, et rien ne me paraissait plus extraordinaire que la succession de chemins asphaltés menant à Boston.
La veille, dans mon appartement loué, j’avais vu Philippe Gilbert triompher sur le vélodrome de Roubaix et le rondelet Patrick Reed affubler Tiger Woods du veston vert à Augusta. Paris-Roubaix en cyclisme, le Masters au golf, Boston en course à pied, la troisième d’avril est toujours la première à marquer au calendrier.
Le matin de la course, très tôt, il fallut prendre un autobus et quitter la belle ville pour atteindre l’obscur village. Dans les tristes ténèbres pleines de vent et de pluie, j’avançai en trottant, en marchant, en courant, croyant faire là un échauffement précoce et salutaire mais ayant trop chaud, cependant que rien n’était plus désagréable dans l’attirail que m’imposaient la Nouvelle-Angleterre et sa météo boudeuse. Un poncho en plastique, du genre de ceux qui – recevant la pluie, mais tenant captive la sueur – restent mouillés en tout point, et des sacs blancs d’épicerie noués aux chevilles plombaient mon allure, un peu le moral aussi, semblaient menacer jusqu’au temps que j’espérais fracasser dans quelques heures. Des petits fantômes, frères et sœurs d’armes, de partout surgissaient d’entre les bâtiments endormis, sur les rues noires que seuls éclairaient les feux de circulation tricolores. Peut-être formions-nous alors, minable procession de ponchos, aux yeux indifférents des passants qui s’en allaient travailler, l’étonnant rappel du bordel à venir dans leur métropole, comme un second cadran du matin qui marquait pour nous plus que pour eux une grande et importante journée.
Dans l’autobus, je pris place aux côtés d’une femme de mon âge, puis entamai mon gruau pris en pain sur l’étroite banquette brune de mon enfance. Durant l’interminable trajet, je m’excusai trop de fois auprès d’elle, lançant niaiseusement : « Sorry, sorry, I hope it’s OK », comme si avaler de l’avoine en poncho dans un autobus scolaire relevait du péché. L’expiation, elle me l’offrit pourtant chaque fois qu’elle osait cette gentillesse : « No, no, of course, go ahead, it looks good ».
Parvenus sur les lieux du départ, ce fut la guerre pour trouver abri, car avant même le manque de sommeil, le surentraînement, le sous-entraînement, les blessures, les ressorts imprévisibles de la digestion, la mauvaise connectivité GPS, la prime crainte du coureur le matin de la course est de mouiller l’empeigne neuve de ses souliers. Des tentes à perte de vue abritaient des mines flegmatiques, rêveuses, absentes, cordées serrées, les plus chanceux assis sur la pelouse humide, les autres debout à scruter le prochain à se dépêcher vers les toilettes chimiques. Moi-même dus m’y résoudre à la toute fin, après près de deux heures d’immobilisme, et quitter mon bout de gazon à regret, mais les files indiennes tous azimuts vers les toilettes me bloquaient déjà la voie, m’empêchèrent d’espérer pouvoir vider mon thermos de café plein la vessie et les boyaux à temps pour le départ.
Ma qualification inespérée, le temps au marathon de Philadelphie à abaisser à tout prix, la vigueur relative de mes jambes, ma présence même à Boston, tout cela disparu, mis en sourdine par mon ventre prêt à éclater. Le départ était imminent. Dans la cohue, il fallut me débarrasser de mes collants, lambeaux rouge et bleu, vieilles étoffes élimées portant en dégradé le nom de mon ancien club de ski de fond : Fondeurs Laurentides. Tout était fourré dans de larges poches que tenaient ouvertes les bénévoles contents. Thermos, sac à dos, poncho, perdus aussi pour toujours.
J’hésitai à retirer ma casquette pendant l’hymne américain, la calotte sur le cœur me semblait une peine dont le Québec et les autres nations pouvaient bien être exonérés. Au coup de départ fusant enfin vers un soleil qui nous surplomberait toute la journée, nous nous enfonçâmes mais trop lentement, sans propulsion franche, comme un déversement de boue, avec tout juste l’élan gravitationnel. Sur les bordures de trottoir, entre les boîtes aux lettres, sur les terrains mêmes des badauds qui applaudissaient devant leurs maisons victoriennes, et dans l’atmosphère desquelles lévitaient des relents de saucisses et de boulettes (les Américains rompus le matin au barbecue plus qu’à l’athlétisme), je m’affairai à contourner, dépasser, enjamber, rattraper. Au premier point de ravitaillement, le bitume était patinoire, et il fallut force adresse parmi les torrents d’eau et de Gatorade, jonchés de milliers de petits cônes de carton et de quelques épaves (trois ou quatre corps échoués sur le sol glissant). Les montres hurlaient, les drapeaux virevoltaient, nous étions bel et bien chez nos voisins du sud.
Si d’un long trait ma Garmin put dessiner mon allure (le pace, oracle du coureur, l’aiguillant au paradis ou tout droit en enfer), un cardiologue d’abord inquiet se serait réjoui de le voir décoller enfin au trente-deuxième assaut (kilomètre), piquant vers la stratosphère et tergiversant dans les hauteurs jusqu’à la fin, et aurait cru y déceler une renaissance de cœur. L’inverse, manifestement, se produisit, ou plutôt rien de tout cela, car alors que je courrai les deux premières heures à cadence de métronome comme un champion, j’avais la mort aux jambes. Mon sang fumait à gros bouillons (le poncho, coupable?). Vivant, je ne l’étais que d’après la sonnerie de ma montre qui me le rappelait nonchalamment, chaque kilomètre. Mais je tenais bon pourtant, je ne sais comment, enfin si : par orgueil, à coup sûr. Et ce n’est pas par poésie de la mise en abîme ni par penchant métaphorique que je m’arrêtai finalement dans la célèbre Heartbreak Hill, côtelette terrible, puis marchai défait les kilomètres suivants. Ma blonde me dit plus tard qu’à ce moment, elle qui suivait avec son père la course à la maison (bien enceinte et clouée là pour des raisons d’assurance), vit le cercle GPS portant mon nom disparaître soudainement de l’application sur son téléphone. Volatilisé, car trop lent. Quelque part, dans la stratosphère, je suçais un popsicle orange, philosophais sur les racines de l’existence en pensant au classique de Kundera, que je n’avais par ailleurs jamais lu : la vie est ailleurs.
Je fus le premier de retour dans l’appartement, tandis que ma mère en digne maman (qui m’avait accompagné dans mon escapade bostonnaise, ma grande sœur et ses enfants aussi) cherchait son fils parmi lits et civières de l’infirmerie non loin de l’arrivée. Au souper, une fois tous réunis, ma sœur qui connaissait pourtant bien son frère et devinait aisément mon amertume, devisa avec sagesse et un trop franc sourire :
« C’est une bonne leçon de vie, peut-être la meilleure chose qui puisse t’arriver. »
Mon frère me dit la même chose au téléphone. Dans deux semaines, ma fille verrait le jour, en détournerait le tranquille cours, et m’apprendrait que ces petites défaites ne sont rien. Ma sœur et mon frère avaient entièrement raison, mais je n’étais pas encore père, et avant de le devenir, je continuais à jouer le gamin ébauchant de grands rêves, ébauchant en secret ce soir-là au sein du tumulte des analyses post-course et méta-analyses de vie un souhait inavouable et incertain : Boston, dans ta grande ornière je reviendrai.
***
Le titre de mon dernier (et premier) article, Fartlek, ne cherchait pas à tromper le lecteur, mais en jeta quelques-uns dans une inévitable méprise. Ce terme suédois, désignant étymologiquement un jeu de vitesse, trouve aujourd’hui d’amoindris échos à l’ère des plans d’entraînement, de la souffrance orchestrée, structurée, chiffrée. Le fartlek, ostentatoirement dépourvu de cadre, de règles, décliné en vitesse selon l’agrément du sujet, d’après les ondulations du sol et les soubresauts de la volonté, échappe tout à fait à la mesure. À l’image, en bref, de mon texte fuyant et un peu comme la plume – brouillonne, changeante, ludique – dont le jeu sans cesse dissimulé est celui de la démesure.